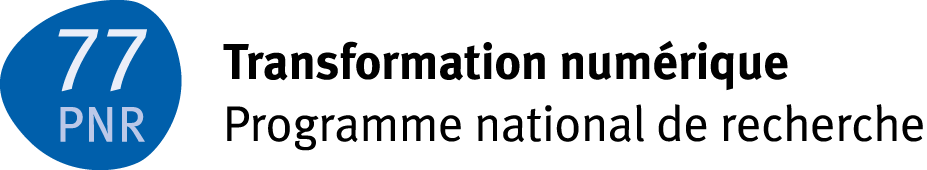Repenser la démocratie : plus de légitimité grâce aux votes proportionnels

L’ère du numérique ouvre la voie à de nouvelles façons de voter. Et si l’on repensait les votes ? Qu’est-ce qui est considéré comme légitime ? Une étude montre que des votes proportionnels permettent une plus grande légitimité.
L’avènement de l’ère numérique rend possible l’utilisation de plateformes en ligne pour voter. Mais quel est l’impact de tels instruments sur la confiance dans les institutions démocratiques et la légitimité politique ? Un projet de recherche dirigé par Regula Hänggli (Université de Fribourg) a pris comme étude de cas le projet « Participatory Budgeting » d’Aarau afin de répondre à cette question. Lors de ce projet, les citoyennes et citoyens d’Aarau pouvaient soumettre des projets qu’ils souhaitaient voir mis en œuvre dans leur ville. Une étude de faisabilité avait ensuite été réalisée, après quoi les habitantes et habitants avaient pu se prononcer sur les projets dans le cadre d’un vote proportionnel en ligne. Contrairement à la pratique habituelle, chaque personne ne disposait pas d’une seule voix, mais pouvait répartir dix points entre au moins trois projets. À l’inverse des votes à la majorité, où le projet qui remporte le plus de voix l’emporte, le budget du projet jouait également un rôle ici. Chaque personne s’était en effet vu attribuer une part égale du budget, lequel ne pouvait être utilisé que pour financer les projets pour lesquels la personne avait voté. Ainsi, un projet était sélectionné uniquement s’il pouvait être financé par les parts du budget des personnes qui avaient voté pour lui. Les projets plus coûteux nécessitaient donc davantage de voix. Les projets avaient pour finir été concrétisés en s’appuyant sur le budget disponible.
Principales conclusions de cette étude de cas
Cette méthode avait permis à la population de la ville d’Aarau de soumettre un vote électronique sur 33 projets différents, dont 17 avaient été sélectionnés et réalisés jusqu’à la fin 2024. Avant et après la phase de mise en œuvre, la population avait en outre été interrogée sur sa confiance dans le vote, sur sa capacité d’action ainsi que sur la légitimité du vote afin d’étudier les variations de l’opinion et du comportement. Or, l’étude de cas a montré que l’utilisation d’une méthode de vote proportionnelle renforçait la légitimité et la confiance dans les institutions.
En outre, les outils numériques semblent bénéfiques lorsqu’ils sont conçus dès le départ pour répondre aux besoins des utilisatrices et utilisateurs et qu’ils combinent les exigences techniques avec les valeurs démocratiques (conception basée sur les valeurs). La transparence des processus, des critères de décision et des responsabilités est nécessaire pour que les procédures numériques soient reconnues comme légitimes par les citoyennes et citoyens. La plateforme doit également être conçue de manière à refléter des valeurs sociales fondamentales, telles que l’équité et l’inclusivité. Enfin, il est nécessaire de mener des enquêtes avant et après le vote pour évaluer et adapter l’impact sur la confiance, la légitimité et la compétence politique.
Conséquences pour la politique et la pratique
Une plateforme en ligne permet aux citoyennes et aux citoyens de participer activement et facilement aux décisions politiques et d’influencer celles-ci. Le projet de recherche a apporté une contribution importante au développement des processus décisionnels démocratiques à l’ère numérique et à la répartition équitable des ressources. Il montre également que le vote à dix points reflète mieux les préférences des électrices et électeurs dans les différentes catégories du projet que le vote à une voix classique. Contrairement aux procédures traditionnelles (basées sur la majorité), les nouvelles méthodes de vote (proportionnelles) peuvent renforcer la légitimité et la confiance. En effet, grâce à la plateforme en ligne d’Aarau, le processus et la nouvelle méthode de vote ont eu un impact direct sur la confiance des participantes et participants dans les processus démocratiques et sur la légitimité accordée aux décisions politiques. Le fait que bon nombre d’habitantes et d’habitants d’Aarau aient souhaité la poursuite du projet témoigne du succès de cette méthode de prise de décision numérique et montre qu’un processus budgétaire est un moyen approprié pour impliquer les citoyennes et citoyens dans l’élaboration des politiques publiques. Les méthodes de vote proportionnelles peuvent être utilisées dans les villes et les communes, mais aussi à l’échelle cantonale et nationale.
Trois messages essentiels
La légitimité a plusieurs dimensions. La perception de la légitimité d’une décision politique dépend de différents facteurs: la possibilité de participer (input), l’équité du processus (throughput) et la satisfaction procurée par les résultats (output). Dans les modes de scrutins traditionnels, ces aspects sont souvent perçus conjointement. Dans le cadre du processus budgétaire participatif et des nouveaux formats ayant servi d’exemple, ces éléments ont été évalués séparément – les participant·es ont réfléchi plus activement à la question de savoir si le processus et le résultat étaient équitables, la qualité du processus s’avérant particulièrement importante à cet égard. Toutefois, même un processus équitable n’est pas à même de compenser entièrement l’insatisfaction éventuellement liée aux résultats, ce qui met en évidence combien la légitimité relève de l’interaction complexe de différentes dimensions.
Les scrutins proportionnels sont considérés comme plus équitables. Par comparaison avec les procédures majoritaires classiques, lorsque les membres de la société peuvent répartir leurs votes entre différents projets et que les suffrages sont décomptés selon une procédure proportionnelle, ils se sentent mieux représentés, perçoivent le processus comme plus équitable et sont plus satisfaits des résultats. Les scrutins proportionnels sont donc susceptibles de renforcer la légitimité sur tous les plans.
Le mode de scrutin devrait être adapté à la situation. Les modes de scrutin peuvent être plus équitables, plus inclusifs et plus crédibles s’ils sont adaptés en fonction des décisions concrètes à prendre. Comme le montre les résultats obtenus, les procédures participatives se révèlent particulièrement utiles dans les cas complexes ou hétérogènes. Les outils numériques offrent de nouvelles possibilités de mettre en œuvre de telles consultations, mais présentent aussi des obstacles, notamment en termes d’accès. Pour que de telles méthodes puissent fonctionner à l’échelle nationale, il conviendra d’approfondir les recherches menées dans ce domaine. Les décisions relatives à la répartition de fonds ou de ressources constituent un champ d’application supplémentaire.
Retrouvez la méthodologie utilisée par l’équipe de recherche et d’autres informations sur la page web du PNR 77 consacrée à ce projet :
Vous pouvez consulter les autres projets menés dans le cadre du Programme national de recherche « Transformation numérique » (PNR 77) à partir de cette page :