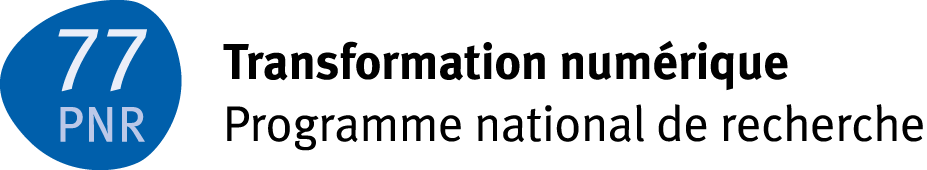Comment les technologies de santé « smart home » peuvent aider les personnes âgées

Les technologies de santé « smart home » sont autant de possibilités d’améliorer les soins des seniors. Leur acceptation, les considérations éthiques et les besoins individuels sont décisifs pour une implémentation réussie.
Un cinquième de la population suisse a déjà au moins 65 ans. Le vieillissement de la société pose de grands défis au système de santé. De nouvelles technologies pourraient permettre aux personnes âgées de vivre plus longtemps chez elles, de manière autonome. C’est le cas des solutions « smart home ». Mais qu’en pensent les personnes concernées et les aidant·es, et quels sont les prérequis à une implémentation sensée ? Un projet de recherche dirigé par Tenzin Wangmo (Université de Bâle) a pour la première fois donné la parole aux seniors, aux familles et aux professionnel·les de santé. Les scientifiques ont identifié le potentiel, les obstacles et les dimensions éthiques de ces technologies à travers une recherche documentaire, des entretiens et une enquête représentative.
Principales conclusions
L’étude révèle que, bien souvent, les personnes âgées ne connaissent pas les technologies de santé « smart home » existantes. Ces applications sont mieux acceptées lorsque leurs avantages sont clairement perceptibles dans la vie quotidienne. Les solutions encourageant la sécurité et l’autonomie sont jugées particulièrement positives. C’est le cas, par exemple, des systèmes d’appel d’urgence ou des fonctionnalités d’aide-mémoire. En revanche, les technologies qui empiètent sur la vie privée ou remplacent les interactions sociales suscitent le scepticisme : caméras de surveillance, capteurs de mouvement et de sommeil, robots de soins ou assistants virtuels, par exemple. Il est important de noter que les personnes âgées ne constituent pas un groupe homogène : les points de vue et les besoins varient considérablement, ce qui rend les solutions standardisées peu efficaces.
Importance pour la sphère politique et la pratique
Les résultats du projet de recherche montrent clairement que les technologies de santé « smart home » ne peuvent pas remplacer les soins personnels. Elles doivent les compléter de façon sensée. Elles peuvent soulager les aidant·es et renforcer l’autonomie des seniors, mais seulement à condition d’être conviviales, personnalisables et de proposer une assistance technique. Cela nécessite des directives éthiques claires, des garanties en matière de protection des données et une implication précoce des personnes concernées dans la conception. En parallèle, une recherche prospective s’impose afin que les progrès techniques fulgurants ne devancent pas le débat social et éthique. La sphère politique, les aidant·es et l’industrie sont appelés à s’unir pour créer des conditions-cadres viables et introduire les innovations de manière responsable dans la vie quotidienne.
Trois messages essentiels
Les technologies de santé « smart home » se révèlent utiles dans certains domaines des soins (pour géolocaliser quelqu’un, par exemple) en complément du travail humain. Elles ne peuvent toutefois pas encore être employées de manière totalement autonome dans les soins actuels aux personnes âgées. Une assistance technique et des connaissances sont nécessaires pour permettre aux seniors d’utiliser ces systèmes de manière efficace et efficiente. Il faut veiller à ce que les personnes aient le choix d’utiliser ou non une technologie, sinon elles ne se sentiront pas à l’aise. La confiance dans les technologies de santé « smart home » et leur intégration dans le quotidien peuvent permettre aux seniors de vivre plus longtemps dans l’environnement qui leur est familier. Cela peut également rendre la charge de soins moins lourde pour les familles et la société.
Nous n’en savons pas encore assez sur les capacités futures des technologies robotiques. Elles devraient évoluer vers la deep tech avec l’avènement de l’IA et la volonté des entreprises de maximiser le recours aux robots dans l’environnement domestique. Cela implique des exigences technologiques élevées, un temps de développement considérable et souvent un impact important sur le quotidien des gens. En outre, les préoccupations éthiques et sociales liées à l’utilisation de robots évolueront avec le progrès technologique et l’application dans différents contextes. La recherche doit être orientée vers l’avenir afin de fournir des recommandations opportunes aux responsables et au public visé concernant le choix des technologies, les éléments à prendre en compte pour une utilisation profitable et les problèmes qui pourraient survenir.
Même si l’évolution démographique en Suisse rend les technologies de santé « smart home » pertinentes, il convient d’approfondir la réflexion avant une introduction à grande échelle. Les données montrent que les personnes les plus âgées, en particulier, se sentent souvent dépassées, ne voient pas l’utilité de ces systèmes et préfèrent les soins humains auxquels elles sont habituées. Elles ne rejettent pas la technologie, mais ne souhaitent pas y recourir. L’acceptation varie fortement d’une génération à l’autre – par exemple entre les plus de 85 ans et les 70-79 ans – ainsi qu’à l’échelle individuelle. Tandis que certaines personnes souhaitent davantage d’assistance et de mesures préventives, d’autres refusent toute intervention dans le processus naturel de vieillissement. Prendre en considération les préférences individuelles et générationnelles est donc essentiel dans l’évaluation et l’introduction de ces technologies.
Retrouvez la méthodologie utilisée par l’équipe de recherche et d’autres informations sur la page web du PNR 77 consacrée à ce projet :
Vous pouvez consulter les autres projets de recherche menés dans le cadre du Programme national de recherche « Transformation numérique » (PNR 77) à partir de cette page :