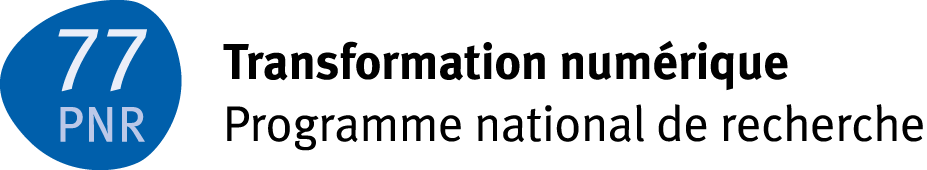Concurrence entre hautes écoles : comment prendre l’avantage grâce à la numérisation

Une étude du PNR 77 montre comment les hautes écoles suisses utilisent la numérisation pour leurs activités, mais aussi pour s’imposer dans la compétition autour des ressources et gagner en réputation et en influence.
Les hautes écoles et les domaines d’étude profitent de la visibilité et de l’importance de la transition numérique pour se profiler, établir de nouvelles filières et sphères de recherche et affirmer leur rôle avant-gardiste. C’est le principal constat d’un projet de recherche du PNR 77 conduit par Katja Rost (Université de Zurich). L’équipe de recherche a étudié les stratégies adoptées par les hautes écoles et les domaines d’étude de Suisse pour se doter d’une avance relative au regard des opportunités identifiées.
Les principaux constats
Les hautes écoles suisses sont en concurrence pour les ressources, le personnel, la visibilité, l’autorité d’interprétation, la réputation et la légitimité. Elles sont nombreuses à utiliser la transformation numérique pour obtenir un avantage stratégique et se positionner favorablement. L’équipe de recherche de l’Institut de sociologie de l’Université de Zurich a choisi l’angle de la transformation numérique pour mettre en évidence la remarquable capacité d’adaptation et d’innovation des hautes écoles et des domaines d’étude.
L’enjeu de la numérisation est aussi particulièrement intéressant parce qu’il concerne presque toutes les disciplines et remodèle non seulement les méthodes scientifiques, mais aussi le travail académique lui-même. Le projet a mis en lumière les différentes dimensions de la transition numérique dans les hautes écoles : sur le plan du contenu, la numérisation fait émerger des champs de recherche, des thématiques, des domaines d’étude et des filières inédits. Sur le plan administratif, elle influe sur le développement d’infrastructures de recherche et d’enseignement et fait évoluer les formats et les méthodes d’enseignement. La digitalisation du travail scientifique – de la collecte des données à la publication en passant par l’évaluation – fait également partie de cette transformation.
Importance pour la politique et la pratique
Les résultats de ce projet donnent un nouvel éclairage sur la manière dont les mécanismes de concurrence favorisent l’innovation et la capacité d’adaptation, et sur les opportunités et les risques qui en découlent pour l’évolution future de l’enseignement supérieur suisse. Le projet a apporté ainsi une contribution importante à la recherche académique et scientifique en Suisse et permet d’observer spécifiquement les processus de transformation à l’œuvre.
Trois messages essentiels
- En Suisse, les hautes écoles autonomes font preuve d’un grand sens de l’initiative et de beaucoup de réactivité lorsqu’il s’agit d’introduire dans le débat public un thème considéré comme pertinent pour l’avenir. Une des principales explications en est que même si elles sont officiellement autonomes, les universités dépendent de ressources matérielles et immatérielles : réputation, attention, soutien financier des structures administratives et, surtout, légitimation de leur financement presque intégralement assuré par des fonds publics. Tous les acteurs concernés – des universités et de leurs unités semi-autonomes aux chercheuses et chercheurs considérés à titre individuel – cherchent à améliorer leur position relative par rapport aux autres afin d’y accéder. Cela génère souvent une compétition qui donne à son tour naissance à différents champs de concurrence en fonction des acteurs et niveaux impliqués. Au sein de tous ces espaces, il est important de distinguer deux dimensions : d’une part, l’appropriation rhétorique du thème de la « numérisation », qui s’inscrit dans le cadre d’une autopromotion et, d’autre part, son intégration scientifique, intellectuelle et thématique dans la recherche, l’enseignement et la formation continue. Les hautes écoles sont très réactives et créatives lorsqu’il s’agit de se positionner comme des acteurs pertinents, ou d’exploiter un thème d’actualité pour promouvoir leurs intérêts et objectifs. Cet état de fait démontre, en tout cas jusqu’à un certain point, que le système de gouvernance et de financement élaboré suite aux réformes introduites depuis les années 1990 exerce des effets positifs.
- La compétition est de mise au sein du système universitaire suisse. Elle influe sur la disposition des acteurs concernés à se saisir activement des thèmes émergents afin d’avoir de nouvelles opportunités de poursuivre leurs propres intérêts.
Les administrations, les scientifiques, les groupes de recherche, les domaines d’étude et les communautés interdisciplinaires tentent à tous les niveaux d’obtenir des avantages relatifs dans la compétition qui se joue autour des moyens financiers, du personnel, des postes, de l’attention, de l’autorité d’interprétation, de la réputation et de la légitimité. L’étude du thème de la « numérisation » a révélé que cette mise en concurrence est multiforme – ou plutôt que de nombreux acteurs s’emparent de ce sujet en vue d’occuper le devant de la scène et de prendre de l’avance dans la course aux ressources. Deux conclusions s’imposent : dans une perspective élargie, la transition numérique peut être entendue comme une opportunité d’analyser et de comprendre la capacité d’adaptation et d’innovation des hautes écoles lorsqu’elles sont confrontées à des questions novatrices et partiellement susceptibles d’induire une mise en concurrence. Considéré sous cet angle, le tournant numérique offre un modèle qui permet de surveiller la compétitivité et les stratégies mises en œuvre par les hautes écoles comme par les chercheuses et chercheurs. Il fournit un exemple intéressant parce qu’il constitue un défi pour presque toutes les disciplines et qu’il entraîne des modifications aussi bien des méthodes scientifiques que du travail en lui-même. D’un point de vue plus spécifique, ce cadre concurrentiel peut également faciliter l’analyse et la compréhension des activités numériques mises en œuvre au sein des hautes écoles et du monde scientifique. - Ce projet a contribué à clarifier les dimensions dans lesquelles la transition numérique peut être observée et étudiée dans et par les hautes écoles. Très générale, cette notion englobe des processus variés qui se déploient sous de multiples facettes. Eu égard à l’enseignement supérieur suisse, l’équipe de recherche a choisi d’examiner de manière empirique certaines dimensions de ce changement, en se concentrant sur celles qui sont motivées par une approche proactive et la poursuite de différents intérêts – que ce soit dans une logique bottom-up ou top-down. En termes de contenu, ces dimensions intègrent de nouveaux domaines et thèmes de recherche, de nouvelles disciplines, mais aussi de nouveaux cursus. Au niveau administratif, ce sont les infrastructures de recherche et d’enseignement ainsi que la composante didactique des supports et des formes d’enseignement qui apparaissent pertinentes. Enfin, les aspects que constituent la numérisation, la publication et l’évaluation des travaux scientifiques complètent cet ensemble auquel s’ajoutent les effets externes exercés par les activités de recherche et d’enseignement des hautes écoles.
Vous trouverez des informations sur la méthode utilisée par l’équipe de recherche et d’autres indications relatives au projet sur la page Internet de ce projet du PNR 77 :
D’autres projets de recherche à l’enseigne de la « Transformation numérique » menés dans le cadre du Programme national de recherche PNR 77 figurent ici :