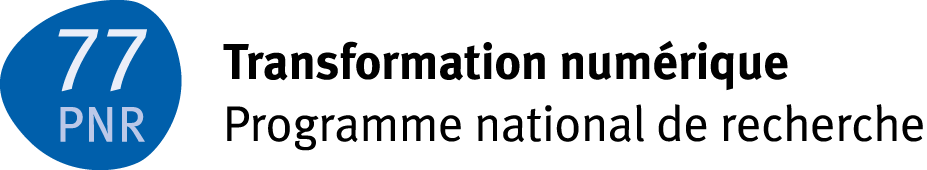Nouveaux venus à l’école : comment s’établit la confiance avec les robots ?

Comment s’établit la confiance dans les robots éducatifs à l’école ? Sont-ils acceptés ? Comme le démontre une étude, l’enjeu n’est pas tant technique mais porte essentiellement sur des aspects sociaux, pédagogiques et politiques.
Les écoles utilisent de plus en plus des robots éducatifs tels que « Thymio » ou « Blue-Bot ». Ces automates physiques, qui initient les enfants à la programmation et la robotique, sont conçus pour une utilisation en classe. Néanmoins, le public leur réserve un accueil mitigé, l’utilisation de robots éducatifs se heurtant aux mêmes résistances que les nouvelles technologies ou l’intelligence artificielle. Qu’en pensent les élèves et le corps enseignant ? Un projet de recherche dirigé par Marc Audétat (Université de Lausanne) a combiné l’analyse des interactions entre élèves, enseignant·es et robots à la réalisation de nouvelles expériences pédagogiques en classe.
Principales conclusions
La confiance n’est pas innée : elle se construit au fil d’interactions actives et positives avec les robots éducatifs. Le regard qui est porté sur l’utilisation des robots en classe et les bénéfices escomptés dépendent également du cadre institutionnel et du discours public. L’intégration intelligente des automates dans les cours implique que les élèves et le corps enseignant adaptent leurs routines et mettent en place des expériences pédagogiques – l’une d’entre elles ayant montré que les élèves développent des stratégies créatives dans leurs interactions avec les robots. Autre constat tout à fait intéressant : des enfants ayant des besoins particuliers ont progressé grâce à l’apprentissage avec des robots. Leur utilisation a, par exemple, permis d’améliorer l’interaction sociale des élèves atteints d’un trouble du spectre autistique.
Enjeux politiques et pratiques
L’étude révèle que la réussite des réformes éducatives dans le domaine du numérique dépend non seulement de la technologie en elle-même mais, plus encore, de l’implication du corps enseignant, des élèves et des expert·es dans leur conception. L’utilisation de robots requiert des conditions-cadres adéquates, par exemple sous la forme de programmes pilotes ou de lignes directrices. En pratique, les robots éducatifs peuvent stimuler les processus pédagogiques voire offrir de nouvelles perspectives d’apprentissage et d’interaction, notamment pour les enfants ayant des besoins particuliers. Pour être considérés comme de précieux outils d’apprentissage, les robots doivent bénéficier de conditions-cadres appropriées et de la confiance nécessaire.
Trois messages essentiels
Analyser la situation : aborder et répondre à la question de savoir pourquoi et comment la « transformation numérique » est engagée dans la domaine cible de la politique éducative – locale, régionale, nationale. Quels sont les enjeux ? Qui les définit ? Comment l'expertise pédagogique devient-elle partie intégrante du processus politique? Et comment la « confiance dans la technologie » s'est articulée dans les choix de politique éducative?
Tirer les leçons des échecs passés : il n'y a pas de solution technique toute faite à la pédagogie ou à l'éducation numérique. Il ne suffit pas d'introduire des PC, des iPads, ou des robots éducatifs dans les écoles pour avoir une politique d'éducation numérique. Il est essentiel que les objectifs et les contenus pédagogiques soient clairement réfléchis et définis, et que la formation des enseignants soit planifiée et réalisée, comme la réforme dans le canton de Vaud l'a montré – sans quoi la politique d'éducation numérique risque d'être un échec.
Questionner le numérique : Comme toutes les technologies de l'information le font dans chaque contexte d'application, les technologies de l'éducation transforment la pédagogie et les relations sociales dans l'éducation. Il y a une grande différence entre « apprendre pour le numérique » (pratiquer avec les technologies pour acquérir de nouvelles compétences) et « apprendre avec le numérique » (utiliser les technologies pour l'apprentissage dans un domaine existant). Dans les deux cas, les avantages attendus et les inconvénients ne doivent en aucun cas être pris pour acquis, et doivent être au contraire soigneusement expérimentés et évalués avant leur mise en oeuvre. De nombreuses technologies éducatives récemment mises sur le marché ne sont tout simplement pas adaptées et prêtes à entrer dans les écoles.
Vous trouverez toutes les informations concernant la méthodologie utilisée par l’équipe de recherche et le projet en lui-même sur la page web dédiée au PNR 77 :
Vous trouverez d’autres projets de recherche sur la « Transformation numérique » dans le cadre du projet national de recherche PNR 77 ici :